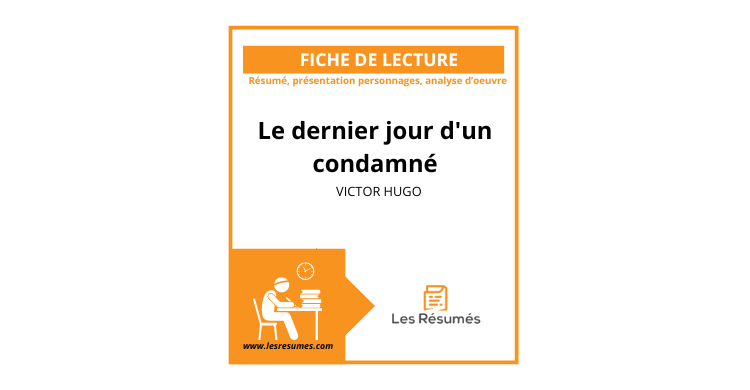Jean-Marie Rouart propose dans son livre « Drôle de justice » une exploration percutante des liens ténus mais persistants entre la littérature et le système judiciaire. Dans sa première partie, l’auteur nous guide à travers ses réflexions personnelles sur les injustices subies et les doutes soulevés par la justice.
L’une des affaires qui a marqué Rouart est celle de Omar Raddad en 1991. Interrogé sur le meurtre d’un membre respecté de sa famille, ce dernier a été accusé malgré son innocence manifeste pour protéger l’honneur familial. Cette injustice a conduit Rouart à se battre pendant des décennies pour obtenir la révision judiciaire du cas et à subir lui-même diverses accusations.
Cet engagement n’est pas isolé ; il s’inscrit dans une longue tradition de défenseurs des droits individuels face au pouvoir, comme Gabrielle Russier ou Dreyfus. Rouart met en évidence le rôle que la littérature a toujours joué dans ces luttes contre l’injustice.
Dans son livre, Rouart examine également comment la société juge déjà avant même un procès et comment certains écrivains se sont levés pour défendre des causes perdues. Il cite par exemple Marcel Aymé qui réussit à nous faire comprendre les aspects sombres de la vie sans pour autant nous déprimer.
La littérature, selon Rouart, représente un refuge contre l’injustice sociale et politique. Elle offre une alternative au conformisme imposé par des lois souvent injustes ou inhumaines, incitant le lecteur à adhérer à une idée plus noble de justice qui respecte les droits naturels de chaque individu.
Dans la seconde partie du livre, Rouart met en pratique ses réflexions dans une pièce de théâtre intitulée « Drôle de Justice », illustrant ainsi sa critique acerbe du système judiciaire actuel.
Ce livre offre non seulement un regard lucide sur les limites et les failles du système judiciaire, mais aussi une invitation à la réflexion sur notre propre responsabilité dans la création d’un monde plus juste.